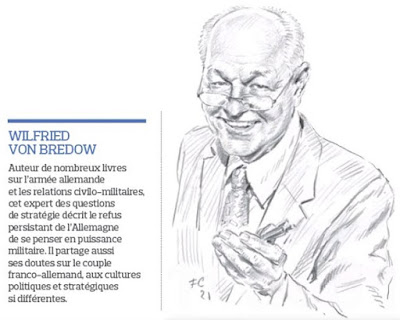L’homme est apparu sur les plateaux de télévision, visiblement affecté. Indigné. De son léger accent allemand, le professeur agrégé a décrit la polémique à l’Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, le placardage de son nom et de celui d’un de ses collègues, avec ces mots, «des fascistes dans nos amphis», les enseignants et la direction de l’IEP, bien sûr solidaires, dénonçant une «mise en danger» par ce placardage et sa di|usion sur les réseaux sociaux, mais sans jamais s’avancer sur le fond. Sans jamais affirmer clairement qu’un professeur refusant le concept d’«islamophobie d’État» et distinguant la «peur de l’islam» de la «détestation envers les musulmans», que l’on soit d’accord ou non avec cette position, n’a rien d’un fasciste.
12/03/2021
Germinal
L’homme est apparu sur les plateaux de télévision, visiblement affecté. Indigné. De son léger accent allemand, le professeur agrégé a décrit la polémique à l’Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, le placardage de son nom et de celui d’un de ses collègues, avec ces mots, «des fascistes dans nos amphis», les enseignants et la direction de l’IEP, bien sûr solidaires, dénonçant une «mise en danger» par ce placardage et sa di|usion sur les réseaux sociaux, mais sans jamais s’avancer sur le fond. Sans jamais affirmer clairement qu’un professeur refusant le concept d’«islamophobie d’État» et distinguant la «peur de l’islam» de la «détestation envers les musulmans», que l’on soit d’accord ou non avec cette position, n’a rien d’un fasciste.
Si les Allemands doivent choisir entre l’Europe et l’Otan, ils choisiront l’Otan
LE FIGARO.- Un grand débat a émergé autour de l’armée allemande à la faveur de la découverte de scandales successifs révélant les sympathies de certains officiers pour des positions d’extrême droite et le passé nazi, suscitant suspicion et volonté de contrôle strict. Cela se produit alors que l’Allemagne semble vouloir prendre meilleur soin de ses forces armées, longtemps négligées. Comment voyez-vous cette situation un peu paradoxale?
Wilfried VON BREDOW. - Ce paradoxe est très profondément installé dans la société allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, les Allemands ont compris que leurs vieilles approches militaristes du XIXe siècle, qui avaient fini par mener aux deux guerres mondiales du XXe siècle, devaient être abandonnées. Ils ont accepté l’idée qu’ils devaient se consacrer à la défense de l’Occident dans un cadre multilatéral. Pendant quarante-cinq ans, jusqu’à l’année 1990, la Bundeswehr («force de défense fédérale», NDLR) a donc été exclusivement destinée à assurer la défense du pays et celle de l’Otan. Ces fonctions étaient réelles, mais pas très visibles. Oui la Bundeswehr existait, mais les gens ne le voyaient pas vraiment. Il n’y avait pas de guerre, la paix était tenue pour acquise. Quand on interrogeait les Allemands à l’époque, ils vous disaient que leur sécurité n’était pas assurée par la Bundeswehr mais par les États-Unis. Ils expliquaient que cela était bien ainsi car nous ne voulions pas d’une armée forte. La violence et la guerre ne pouvaient, par définition, participer à la solution des problèmes politiques. Ce slogan est toujours le même aujourd’hui! C’est la raison pour laquelle, quand des conflits émergent, même dans des zones proches comme la Yougoslavie, la quintessence de la réponse allemande est d’aider sur le plan civil, mais de laisser les nécessités militaires aux autres. C’est une approche sympathique mais pas très réaliste dans le monde d’après 1990, caractérisé par des défis violents qui exigent non seulement du soft power, mais également une armée forte au service de l’action politique. Dans la communauté stratégique allemande, les lacunes de cette attitude sont bien comprises. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, en 2014, le président Gauck, le ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier et la ministre de la Défense de l’époque, Ursula von den Leyen, sont montés au créneau pour expliquer à leurs alliés que l’Allemagne devait s’orienter vers la construction d’une armée plus responsable. Mais ce «consensus de Munich» s’est ensuite évanoui. C’est justement le moment où de nombreux problèmes se sont manifestés au sein de la Bundeswehr, dont la politisation que vous évoquez. Mais le principal défi de l’armée est sa bureaucratie.
Que voulez-vous dire?
Wilfried VON BREDOW. - L’armée a une énorme bureaucratie qui affaiblit la responsabilité individuelle, aussi bien dans la troupe que chez les généraux. Tous tentent de renvoyer sur les autres quand il y a un problème. C’est surtout le résultat du fait que la société civile allemande ne se préoccupe pas vraiment des forces armées. Les militaires ressentent ce manque d’intérêt depuis très longtemps. L’attitude de la société, orientée vers le pacifisme, n’est pas amicale. C’est sans doute beaucoup mieux que la vieille attitude militariste allemande. Mais on a le sentiment que le pendule est vraiment parti trop loin dans l’autre sens. Il y a donc des raisons à la fois internes et sociétales à l’état déplorable de nos forces armées.
Qu’entendez-vous par «état déplorable»? Il y a eu apparemment de nombreux déboires. Mais une modernisation n’a-t-elle pas été lancée, avec un plan précis, à partir de 2016?
Wilfried VON BREDOW. -Il faut admettre que depuis quelques années, le budget de l’armée a augmenté. Mais cela n’a pas changé grand-chose, à cause de la structure organisationnelle. L’équipement de la Bundeswehr continue de ne pas bien fonctionner, il y a eu des scandales avec la mise en service d’un nouveau fusil, les capacités aériennes restent limitées… Au fond, le pouvoir civil n’a pas réussi à mettre en oeuvre de vraies réformes, bien qu’il se soit attelé à cette tâche. On a des déclarations, des livres blancs, mais les intentions proclamées sur le fait qu’il faut faire émerger une nouvelle culture stratégique, n’ont pas changé grand-chose. Si on attendait des militaires qu’ils se comportent en soldats, de manière créative, ils auraient une incitation à faire évoluer les choses. Mais comme cette incitation n’existe pas, ils travaillent comme des bureaucrates.
Peut-on dire que les Allemands ne font pas confiance à leurs militaires? Ou qu’ils ne se font pas confiance à eux-mêmes pour avoir une armée efficace?
Wilfried VON BREDOW. -Je dirais plutôt qu’ils ne se font pas confiance pour avoir une armée qui en soit vraiment une. Dans les sondages, la Bundeswehr est généralement perçue très positivement. Mais la population juge que l’armée est utile pour faire face aux catastrophes naturelles ou aider à construire des écoles en Afghanistan… En revanche, les Allemands renâclent toujours à l’idée que l’armée puisse être une force combattante. Pendant notre engagement en Afghanistan, j’ai cru que cette approche allait changer, quand notre mission s’est retrouvée prise dans des combats très durs après 2008. Le soldat de la Bundeswehr a dû se battre, ce qui a été une surprise pour le contingent déployé et pour la société. Mais cela n’a pas eu l’effet escompté. Avoir une armée prête au combat n’apparaît pas comme une évidence. Je dirais, au risque d’exagérer, que le militaire reste un alien pour la société allemande. Il ne s’agit pas de revenir à la tradition des temps anciens mais il me paraît clair qu’il faut une évolution. On ne peut pas s’en remettre au commerce pour naviguer à travers les turbulences de ce nouveau monde.
Est-ce le terreau sur lequel fleurit la radicalisation de certains officiers et soldats, nostalgiques d’une armée forte et se sentant mal-aimés?
Wilfried VON BREDOW. - On assiste en effet au réveil très clair de partis de droite comme l’AfD qui voient l’armée positivement et ont des idées très différentes sur le rôle possible de l’Allemagne. Cela participe aussi d’une désaffection plus générale de l’idée européenne, qui fut si longtemps chère au coeur des Allemands. Les gens commencent à se dire que l’idée d’une Union européenne «toujours plus proche» ne fonctionne pas, ni d’ailleurs la solidarité transatlantique, en tout cas à l’époque Trump. Le fossé entre les idées pacifistes de la majorité des Allemands et la réalité grandit, menant nombre de personnes à chercher d’autres voies.
La tentation extrémiste s’explique-t-elle par le fait que la profession militaire n’attirant pas la majorité pacifiste séduit plutôt une population portée sur les armes et plus radicale ? Avez-vous un problème de recrutement?
Wilfried VON BREDOW. - Nous avons un vrai problème de recrutement, et pas seulement parce que ceux qui sont tentés par la carrière militaire peuvent être plus attirés par la droite extrême. Le problème est surtout que quand l’économie va bien, l’armée n’est pas un secteur professionnel attractif. C’est une des raisons pour lesquelles la Bundeswehr a été heureuse d’ouvrir ses rangs aux femmes, qui représentent un contingent croissant et remarquable. Pour revenir à la question de l’extrême droite, nous avons un problème ancien lié aux traditions militaires. Les militaires ont besoin de traditions professionnelles. Or après la guerre, il a été décidé de couper toute référence à celles de la Wehrmacht. On ne voyait en elle que l’organisation criminelle, l’armée hitlérienne, alors que cela n’est qu’une partie de l’histoire car la majorité des soldats n’ont pas commis de crimes. Cette rupture a nourri un ressentiment dans des unités, comme les troupes d’élite KSK où l’on en est venu à ressusciter certaines pratiques extrémistes « de chants et saluts nazis », etc. Ces écarts seront punis. Mais il ne faut pas sous-estimer le contexte qui est celui de la montée des idées du parti Alternative pour l’Allemagne dans le pays. Ce climat crée des conditions favorables pour une expansion des idées d’extrême droite dans l’armée.
La radicalisation cache-t-elle un malaise lié à la résurgence de l’identité nationale, que les Allemands avaient dû congédier en raison du nazisme?
Wilfried VON BREDOW. - La question de l’identité nationale a été un sujet très difficile après 1945. Les années du national-socialisme ont discrédité le sentiment national. L’Allemagne s’est alors définie comme un État postnational. Nous avons embrassé l’Europe et l’identité européenne comme substitut et cru avec enthousiasme à l’idée des États-Unis d’Europe. Mais cette identité européenne est en train de s’évaporer et nous avons besoin d’un nouveau sentiment national d’appartenance… La construction de l’Europe est encore suffisamment forte pour amarrer l’identité nationale à une identité multinationale européenne mais il y a une incompréhension entre les Français et les Allemands sur ce qu’il faut faire. Le dialogue franco-allemand reste très superficiel alors qu’il est le seul moteur susceptible de faire avancer l’Europe. Les déclarations se succèdent sans créer de vraie dynamique. Il n’y a pas de vision, pas de détermination allemande à sortir de ce semi-engagement. Le malaise actuel va donc perdurer au niveau de l’Otan comme de l’UE.
Emmanuel Macron n’a-t-il pas raison de croire à l’émergence d’une souveraineté européenne? Il y a un manque de confiance, en dépit de décennies de travail commun?
Wilfried VON BREDOW. - J’ai bien peur que oui. Votre président est toujours très prompt à sortir de brillantes phrases rhétoriques comme son évaluation de l’Otan en «état de mort cérébrale». Cela n’aide pas! Cette idée que la France et l’Allemagne devraient agir ensemble est sympathique, mais les différences de culture politique et militaire sont énormes. La brigade franco-allemande est une hirondelle qui ne fait pas le printemps. Le couple fonctionne seulement dans les mots, ce qui suscite une mélancolie, car sans moteur franco-allemand pas d’Europe. La réalité est que si les Allemands doivent choisir entre l’Europe et l’Otan, ils choisiront l’Otan. C’est vrai en dépit du processus de décision américain et de l’épisode Trump. Nous parlons de perspective européenne et intégrons des bataillons est-européens à notre armée, mais cela reste totalement symbolique. Pour le reste, nous sommes contents de nous en remettre à l’Otan.